En février 1943 la Relève volontaire se mua en Service du Travail Obligatoire (STO) et des jeunes gens partirent se cacher dans les bois. Le service de la Propagande les traita de réfractaires et de mauvais Français. Beaucoup de Sablais ne furent pas de cet avis et des familles entières abandonnèrent le camp de Pétain. Le vent tournait.
Sourd au grincement des girouettes, Antoine, imperturbable, vint déraciner sa famille. Il repartit vers le nord, vers son destin, en emmenant sa femme, enceinte comme le donjon de Carcassonne, ainsi que ses trois plus jeunes fils et leur sœur Charlotte née en novembre 41. Les dés étaient jetés.
Abandonné définitivement à la grand-mère, notre gamin des rues redevient fils unique. Il est toujours aussi studieux, mais il est écœuré par la perspective d’avoir à refaire, l'an prochain, la classe du certificat d’études primaires car il est désormais interdit de se présenter à cet examen avant l'âge de quatorze ans. Au lieu du CEP il a dû passer le DEPP (diplôme d’études primaires préparatoires) et il a le sentiment d’avoir été couillonné, comme on dit ici. Le DEPP est ce nouveau diplôme que l’on passe à douze ans, et c’est son âge, mais il aurait pu le présenter il y a trois ans s’il avait existé et être reçu haut la main. Son rêve de devenir officier de marine s’éloigne. Allait-il regretter Sorrèze ?
Ils ont bien de la chance ces enfants de riches que l'on retire du primaire à dix ans pour les lancer en classe de septième ou de sixième ! Pour lui c’est trop tard. L’école supérieure s’arrête au brevet élémentaire et de plus elle est laïque et frappée du veto sans appel de la tante. Le seul recours eut été le petit séminaire de Carcassonne, où on l’aurait peut-être accepté gratuitement avec l’espoir de le pêcher et de le pousser à devenir prêtre, comme l’abbé Plancade qui avait célébré sa première messe en fanfare, à l’église Saint-Martin.
![]() Les
Plancade étaient d’Espéraza, mais madame Plancade mère
avait atterri à Sable-de-Rivière et Justin se souvenait de
ses succulentes confitures au début de la guerre, quand le sucre
était encore en vente libre. L’abbé Plancade avait traversé
la Grand-Place en procession et monseigneur Boyer-Mas était venu
pour l’occasion.
Les
Plancade étaient d’Espéraza, mais madame Plancade mère
avait atterri à Sable-de-Rivière et Justin se souvenait de
ses succulentes confitures au début de la guerre, quand le sucre
était encore en vente libre. L’abbé Plancade avait traversé
la Grand-Place en procession et monseigneur Boyer-Mas était venu
pour l’occasion.
![]() Ce
prélat est un monsignore, ou une sorte d’évêque
in
partibus, sans juridiction, de vicaire général anobli.
Il était allé saluer la tante Jeanne, car c’est un ami de
la famille et il avait officié à Sable-de-Rivière,
étant plus jeune. Justin avait eu droit à baiser l’anneau
pastoral et à une bénédiction personnelle, mais pas
question de se laisser séduire. Lorsque vers l’âge de cinq
ans il avait appris qu’un pape ne pouvait être qu’italien, il avait
décidé qu’il ne serait jamais curé ou évêque,
pas même cardinal, car il ne pouvait accepter cet ukase. A quoi bon
embrasser une carrière où la promotion n’était pas
envisageable jusqu’au bout !
Ce
prélat est un monsignore, ou une sorte d’évêque
in
partibus, sans juridiction, de vicaire général anobli.
Il était allé saluer la tante Jeanne, car c’est un ami de
la famille et il avait officié à Sable-de-Rivière,
étant plus jeune. Justin avait eu droit à baiser l’anneau
pastoral et à une bénédiction personnelle, mais pas
question de se laisser séduire. Lorsque vers l’âge de cinq
ans il avait appris qu’un pape ne pouvait être qu’italien, il avait
décidé qu’il ne serait jamais curé ou évêque,
pas même cardinal, car il ne pouvait accepter cet ukase. A quoi bon
embrasser une carrière où la promotion n’était pas
envisageable jusqu’au bout !
Les Frères de la rue du Palais n’ayant plus rien à lui apprendre, le gamin décida de prendre son destin en main. Après la classe, il alla voir monsieur Machin, qui s’appelle maintenant frère Paul et porte robe noire, rabat et tricorne, pour solliciter son aide :
Il fut reçu au concours, mais n’obtint qu’une demi-bourse car il avait fait une erreur dans un calcul. Il en fut mortifié, mais le principal était acquis : on l’acceptait en sixième au Pensionnat de l’Immaculée Conception à Béziers, le PIC, et les Frères réduisirent encore d'un tiers les frais à la charge de la grand-mère.
Dans sa tête, Justin regarde son enfance passer au fil de l'eau. Elle disparaîtra au prochain coude du ruisseau, emportée sans retour. Un copain partira pensionnaire au collège technique de Gourdan-Polignan, à la rentrée. Les autres resteront à Sable-de-Rivière et présenteront le certificat à l’âge requis. La bande ne se retrouvera qu'aux vacances. Tiendra-t-elle la durée de la guerre ? Elle se disloquera de toute façon aux premiers ruts, c'est la loi commune. Bon gré, mal gré, chacun recevra son collier et rejoindra sa niche sociale. Pour certains ce sera un bon abri, pour d'autres une prison. S'ils aboient trop, ils seront muselés. Beaucoup s'épuiseront à tirer sur la chaîne.
Pour l'heure la vie continue, la guerre aussi. Comme les produits pour traiter les légumes sont devenus très rares, les Frères amènent leurs élèves, par classe entière, dans les jardins maraîchers, pour détruire les doryphores. Les enfants se mettent à deux par rangée, accroupis, et cueillent ces insectes présents partout, mais plus nombreux sur les plantes à tubercules. Ce sont de petites bestioles brillantes, rayées de noir et de jaune, grosses comme l’ongle du petit doigt. Il faut bien regarder sous les feuilles pour ne pas en oublier. Ils ramassent aussi leurs larves, sortes d'asticots roses, mous, répugnants. Ils les mettent dans des boîtes de Phoscao. Quand une boîte est pleine, ils le signalent au frère avant d’aller la vider dans un grand seau. Les insectes seront brûlés. Le jardinier les paie à la boîte et l’argent alimente une cagnotte de classe. Leurs copains de l’école laïque vont aussi cueillir les doryphores avec leurs instits, mais ils ne se rencontrent jamais.
Ses cousins de Flassian invitent quelquefois
Justin à la campagne. Leur propriété est toute proche,
à vingt minutes à peine de l'octroi en marchant bien. Ils
le gavent de bonne chère paysanne, d'oie et de canard, de sauces
à mourir de délectation.
 Mange,
mange, mange. Et vlan ! Une autre cuisse de canard. Et vlan ! Une boule
de farce et une pomme de terre. Il aime bien ses cousins, mais leurs repas
lui font peur et il lui arrive maintenant de traîner les pieds pour
leur rendre visite.
Mange,
mange, mange. Et vlan ! Une autre cuisse de canard. Et vlan ! Une boule
de farce et une pomme de terre. Il aime bien ses cousins, mais leurs repas
lui font peur et il lui arrive maintenant de traîner les pieds pour
leur rendre visite.
Pour digérer, Théodore lui propose du rikiki que toujours il refuse.
Au début de la guerre ils allaient alors voir les deux bœufs : Courbé et Mascaré. Ce sont eux qui labouraient les vignes et les champs. Ils avaient chacun une place immuable de part et d'autre du timon. L'été on leur mettait une sorte de filet sur le front pour que les mouches n'aillent pas leur chier dans les yeux. Les bœufs se défendaient eux-mêmes, à grands coups de queue, contre les taons qui essayaient de les piquer aux flancs.
Le sol de la ferme est en terre battue. Il y a une marche à l’entrée de la salle à manger et la pluie n'y entre jamais, aussi est-ce toujours très propre. Il y a des décrottoirs de part et d’autre pour le cas où, comme Justin, on porterait des souliers. Les cousins, eux, mettent des sabots pour vaquer autour des bâtisses et circulent en charentaises dans la maison. Ils vivent à l’heure de la campagne qui est décalée de deux heures en été. Midi correspond ici à deux heures de l’après-midi de la ville. Dans l’ancien temps les ruraux vivaient à l’heure du soleil, c’est-à-dire à celle des cadrans solaires et non pas à celle des montres ou des pendules. Ils en ont gardé l’habitude de se lever tôt et de se coucher de bonne heure.
Le service du ravitaillement impose aux paysans de livrer une partie des récoltes, alors qu’en ville un autre service récupère les métaux non ferreux. Chaque famille est taxée en cuivre, laiton, plomb ou zinc selon un barème qui tient compte de la nature du métal. Si on ne peut fournir le quota, il faut payer une amende. Toutes les plaques de cuivre des notaires et des médecins ont été cachées et remplacées par des plaques de bois ou de marbre. La municipalité a même dissimulé le lion de bronze du monument de la guerre de 70 au Tivoli, tout en faisant du battage pour la collecte. C’est le double langage d’une époque ambiguë. On dit aux gens que ce cuivre servira à faire du sulfate pour soigner la vigne alors que tout le monde sait qu’il sera transformé en munitions pour l’armée allemande. Les récupérateurs, bien secondés par les sergents de ville, sont intraitables. Les gens apportent à la mairie leurs tuyaux de plomb, arrachés ici et là, ou leurs petits sacs pleins de pièces de cuivre à l’effigie de Napoléon III, empereur, ou de Victor-Emmanuel II, roi d’Italie. Tous les enfants possèdent de ces grosses pièces démonétisées et voilà qu’aujourd’hui beaucoup de parents les reprennent dans les cartons à jouets, et volent même quelques soldats de plomb au passage pour faire le poids.
Les civils sont moins nombreux aux cafés de la Grand-Place où l’alcool, les liqueurs, le café sont réservés à l’occupant, mais ils continuent d’aller aux bistrots périphériques où ils peuvent se faire servir sans ticket de la limonade saccharinée ou de la bière locale. L’absinthe est interdite depuis des lustres. Justin se souvient qu’on en servait en secret aux habitués avant la guerre, son grand-père et ses vieux amis étant restés un temps réfractaires à la nouvelle boisson jaune qui l’avait remplacée et qui s’appelait Pernod ou pastis de Marseille.
Devant certains commerces, comme les boulangeries et les boucheries par exemple, on fait toujours la queue pour entrer. Ailleurs c'est en fonction des arrivages. C'est que le système des tickets retarde le service. Tout est pesé à un poil près. A défaut de quantité, les premiers clients espèrent bien rafler la meilleure marchandise, la plus fraîche, la moins avariée. C'est assez illusoire car les bons morceaux sont souvent réservées aux amis ou se négocient au marché noir et en cachette. D'incroyables ersatz ont remplacé les produits de qualité. Des odeurs de rance, de chimie, de moisi, flottent sur les étagères. Des pains abrasifs sont baptisés savon. Ils agressent la peau et ne moussent pas. Même le pinard est rationné, un comble !
Les gamins vont souvent traîner chez Madeleine, à l'angle de Saint-Martin et du Pont-Neuf. C’est le café de monsieur Brych, qui a un nom alsacien et une brasserie rue de la Bladerie, près de la maison de monsieur Galinier, le transporteur hippomobile. Monsieur Lenfant, l’organiste, habite le même quartier. Il y a aussi l’abuela, mère du peintre Barruque, celui qui peint des paysages avec des nuages roses. Chez Madeleine, les clients sont plutôt gaullistes ou espagnols, jouent avec d’étranges cartes pleines de massues et d’étoiles et poussent des jurons terribles quand ils perdent.
Chaque famille vit son drame propre, hésite entre Londres et Vichy et choisit en tremblant. Justin se dit que les gens sont décontenancés, à l’exception sans doute des très riches et des banquiers qui eux ne perdent jamais le nord. Il arrive à la tante d’être antigaulliste et antipétainiste dans la même semaine, mais elle redevient toujours pétainiste car le Maréchal est quelqu’un de leur bord. Les nouvelles sont chaotiques et l’on ne sait plus à quel saint se vouer. Les commerçants essayent de deviner de quel côté penchent leurs clients avant de parler d’autre chose que de la pluie et du beau temps, car il ne faut pas dire n’importe quoi devant n’importe qui si l’on ne veut pas risquer d’avoir un jour des histoires. Les enfants, eux, n’ont pas cette prudence. Ils se parlent franchement et restent bons camarades malgré le choix de leurs parents.
Les grands frères de deux copains de Justin sont partis se cacher dans les bois avec leurs amis qui n'ont pas voulu aller au S.T.O. ou qui s'en sont échappés. Pour l'un d'eux, qui est d'ascendance espagnole, c’est normal puisque Pétain était l’ami de Franco en Espagne, point final. La plupart des Espagnols de Sable-de-Rivière sont installés dans la région depuis longtemps et les démons de la guerre civile ne sont pas venus les harceler. Ce sont des gens comme tout le monde : les riches vont beaucoup à l'église et ont le cœur qui penche à droite, les pauvres préfèrent le cinéma et ont le myocarde plus rouge, quant aux réfugiés de 39, on les trouve surtout dans les villages et les fermes à l'entour.
Cette histoire de S.T.O. a été déterminante pour le renforcement des maquis car c'est ainsi que l'on appelle dorénavant les groupes de réfractaires. Justin trouve que ça fait un peu bandit corse et il aurait préféré garrigue à maquis. On en avait discuté à table et la tante Mathilda avait même déclaré qu’elle préférerait devenir garriguette et se cacher dans les taillis plutôt que d’aller travailler en Allemagne, mais depuis qu’elle sait qu’elle ne risque plus d’y aller et qu’il y a beaucoup d’Espagnols et de communistes dans la forêt, elle prétend n’avoir jamais dit ça. Mathilda la patriote est persuadée d'avoir l'âme bleue, blanche et rouge mais avec beaucoup de blanc et juste un filet de rouge car le bleu et le blanc sont les couleurs de la Sainte Vierge et le rouge est la couleur du diable.
Les Sablais sortent de leur hébétude. Les familles se fissurent. On se bat froid entre cousins, entre frères et sœurs parfois. Les paroissiens de Saint-Martin ne sont plus aussi largement pétainistes qu’autrefois et beaucoup supplient le Seigneur de les éclairer sur le parti à prendre. Un fils Lacroux, neveu de mademoiselle Huc, la modiste, est parti en secret rejoindre de Gaulle. Chaque mois de nouveaux jeunes gens vont grossir les rangs des réfractaires maintenant organisés en groupes armés de francs-tireurs et partisans (FTP) et d'autres, plus rares, ceux de la milice qui vient d'être créée par Darnand. En ville, les Allemands tiennent plus que jamais le haut du pavé et maintenant tout le monde a vraiment peur. Un couvre-feu a été instauré et les nuits sont devenues angoissantes, pesantes, martelées par le pas des patrouilles.
Comme il paraît lointain le temps où les galopins se disputaient les rues de la ville, avec leurs pals empruntés en douce au tas de bois de monsieur Tisseyre le boulanger de la rue de la mairie et qu'ils rapportaient après usage. Ils étaient aussi armés de lance-pierres à élastique baptisés frondes. On trouvait là Dédé, le jeune fils du boucher du coin, Roro, le fils du peintre, René, Antoine, Manolo, Maurice, Jojo, les deux Jeannot et quelques catéchumènes impatients d'être admis à part entière. Le petit groupe original était devenu plus important lorsque André et Justin avaient migré vers la Grand-Place. De nouveaux venus avaient alors grossi la bande dont le territoire s'étendait désormais de l'esplanade au Pont-Neuf, mis à part l'enclave du Paradou où fonctionnait une tribu rivale.
Ces bandes n’étaient pas des gangs de voyous comme dans les quartiers mal famés des métropoles, mais seulement de petites troupes bien commodes pour jouer dans la rue. Il y avait ainsi, outre la bande du Paradou et celle de Justin qu’on appelait désormais la bande de la Mairie, celle des Augustins, celle du Tivoli, celle du Palais où étaient alors ses frères, celle de la Goutine et celle de l’Aragou, la plus importante, et contre laquelle plusieurs des autres se liguaient parfois, sans oublier la bande des Marronniers, la plus lointaine.
Regroupés, les gamins devenaient plus hardis et faisaient pas mal de bêtises. Ils essayaient de casser des carreaux aux fenêtres de l’hospice en lançant des cailloux par-dessus la rivière. C’était une épreuve sportive qu'ils savaient impossible et ils n’y étaient jamais parvenus, d’autant qu’ils s’astreignaient à lancer à partir du point le plus lointain de l’autre rive, depuis le pied du mur du jardin de la sous-préfecture. Les fenêtres ne leur servaient qu’à viser et tous les cailloux tombaient à l’eau. Ils avaient cependant des émules qui tiraient de beaucoup plus près et les sergents de ville les avaient dans le collimateur et les mettaient tous dans le même sac.
 Dans
la journée, le jouet de rue à la mode était "la planchette",
ou carriole à roulettes si vous préférez. On la confectionnait
avec un petit plateau de bois d’environ quarante centimètres sur
soixante, arraché à quelque caisse. Les deux angles du fond
étaient chacun équipés d’un roulement à billes
pris au rancard. A l’avant une barre rigide pivotait autour d’un axe vertical
au-dessus d’un troisième roulement qui permettait le pilotage de
l’engin. C’était bruyant et casse-gueule. Comme la pénurie
de carburant et les réquisitions limitaient la circulation automobile
à quelques gazogènes faiblards, les gamins étaient
les rois de la chaussée. Ventre à ras de terre, ils dévalaient
les pavés de la Goutine dans un boucan infernal et virevoltaient
sur la Grand-Place entre les passants.
Dans
la journée, le jouet de rue à la mode était "la planchette",
ou carriole à roulettes si vous préférez. On la confectionnait
avec un petit plateau de bois d’environ quarante centimètres sur
soixante, arraché à quelque caisse. Les deux angles du fond
étaient chacun équipés d’un roulement à billes
pris au rancard. A l’avant une barre rigide pivotait autour d’un axe vertical
au-dessus d’un troisième roulement qui permettait le pilotage de
l’engin. C’était bruyant et casse-gueule. Comme la pénurie
de carburant et les réquisitions limitaient la circulation automobile
à quelques gazogènes faiblards, les gamins étaient
les rois de la chaussée. Ventre à ras de terre, ils dévalaient
les pavés de la Goutine dans un boucan infernal et virevoltaient
sur la Grand-Place entre les passants.
En soirée, ils pratiquaient volontiers "le tustet", spécialité héritée de leurs aînés. Ça consiste à frapper à une porte et à aller se cacher un peu plus loin pour voir la tête de l’occupant des lieux quand il constate qu’il n’y a personne. Certains opèrent avec une ficelle connectée au heurtoir par un bout de laine, mais les amis de Justin étaient plus directs afin d’afficher leur courage. Ils arrêtèrent ça l’année où les Allemands débarquèrent. Ils n’avaient pas peur, mais les gens oui. Leur dernier tustet, ils l’avaient fait sur la promenade du Tivoli, à un commandant retraité qui était sorti revolver au poing. C’est vers cette époque qu’il leur parût évident que le drame n’allait pas les épargner et ils devinrent des enfants graves.
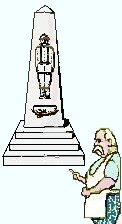 Monsieur
Balateu, héros de la guerre de 14, a démissionné de
la présidence de la Légion des Combattants car il n’est plus
du tout d’accord avec Pétain. Ça a causé du remue-ménage
à la Mairie et en ville. Dédé dit que son frère
est devenu maquisard et qu’il vit maintenant dans les bois du côté
de Montfort-sur-Boulzane. Tout le monde connaît la boucherie près
de l’église, et nul n’ignore que monsieur Balateu a été
enterré vivant par un obus et tenu pour mort. Il est massif et moustachu
et Justin a toujours pensé qu’il avait inspiré le sculpteur
du monument aux morts de la promenade du cimetière en bordure de
la nationale 118, la route d’Albi en Espagne. Ça doit lui faire
drôle de se voir en statue de son vivant, surtout sur un monument
aux morts !
Monsieur
Balateu, héros de la guerre de 14, a démissionné de
la présidence de la Légion des Combattants car il n’est plus
du tout d’accord avec Pétain. Ça a causé du remue-ménage
à la Mairie et en ville. Dédé dit que son frère
est devenu maquisard et qu’il vit maintenant dans les bois du côté
de Montfort-sur-Boulzane. Tout le monde connaît la boucherie près
de l’église, et nul n’ignore que monsieur Balateu a été
enterré vivant par un obus et tenu pour mort. Il est massif et moustachu
et Justin a toujours pensé qu’il avait inspiré le sculpteur
du monument aux morts de la promenade du cimetière en bordure de
la nationale 118, la route d’Albi en Espagne. Ça doit lui faire
drôle de se voir en statue de son vivant, surtout sur un monument
aux morts !
Le plus souvent la bande tourne à sept ou huit. Finies les batailles rangées entre tribus. Les gamins tiennent des conciliabules dans des coins ignorés, derrière des pans de murs, sous une arche du pont Neuf ou sous le tablier du pont de Fer, entre les poutrelles de métal, d’où ils peuvent pêcher des cabots et des soffies. Ils ont appris à piéger les vairons et les goujons dans des bouteilles dont ils font sauter la loupe du cul et qu’ils placent près des rives, le goulot toujours tourné vers l’amont. Ils savent aussi attraper les truites à la main en les coinçant dans les creux des rochers immergés.
 Un
jour Justin a attrapé comme ça une grosse anguille. C’était
la première fois et il n’arrivait pas à la tuer. Même
quand c'est mort, ça remue la queue ! Un type qu’il connaît
bien, car il est éboueur, s’est approché obligeamment :
Un
jour Justin a attrapé comme ça une grosse anguille. C’était
la première fois et il n’arrivait pas à la tuer. Même
quand c'est mort, ça remue la queue ! Un type qu’il connaît
bien, car il est éboueur, s’est approché obligeamment :
Pendant quelque temps Justin lui a fait la gueule. Puis il s’en est consolé en se disant que la grand-mère n’aurait jamais accepté de faire cuire un poisson qui ressemble à un serpent et que la tante aurait sans doute piqué une crise en pensant à la queue du diable.
La petite troupe a la bougeotte. Les enfants quittent volontiers la ville et parcourent des kilomètres pour aller herboriser à Ninaute, se perdre dans le bois d’Autier, sonder les mystères aquatiques du Poupe, patauger dans la Corneilha ou explorer en tremblant la grotte des "Encantadas" (la grotte aux fées). Campés sur des planches, il leur arrive de s’essayer à la glissade sur les aiguilles de pin, dans les bosquets en pente qui surplombent la route d'Alet. Lors de ces escapades, ils gambadent comme des chiots lâchés dans la campagne, libres, grisés de grand air. Puis ils s’apaisent et c'est l'heure de la réflexion.
Assis en rond ils discutent de tout : de Vichy, de radio-Londres, de la guerre en Afrique ou en Russie, de l’assassinat de Darlan, du massacre de Katyn, du marché noir, des attentats, des maquis et de la Gestapo. Ils commentent gravement les choix de leurs aînés en faisant rougeoyer des brins de sureau pour en tirer quelques bouffées. Il leur arrive aussi de fumer vraiment de la barbe de maïs roulée dans du papier Zigzag (avec le zouave) ou Job ou Nil (avec l’éléphant) ou Riz-la-Croix de Mazères sur Salat, mais sans avaler la fumée. Ils laissent à de plus âgés l’avilissant privilège de ramasser les mégots des Allemands. Ils sont devenus des enfants hors d’âge, des petites souris de guerre, invisibles et fureteuses, écoutant tout, lorgnant tout, n’oubliant rien.
Avec de plus grands ils ont essayé, d’abord sans succès, d’apprendre à nager dans l’Aude, près des rochers en face de l’île de Sournies, au bas de la route de saint Polycarpe, et aussi au roc de Montpellier et en aval du roc de Peillou. Par ailleurs, les tenues de plage sont encore l’apanage des Parisiens qui vont aux bains de mer. Pour les messieurs comme pour les dames, la pièce essentielle est le maillot monopièce, à bretelles, descendant à mi-cuisse et généralement noir ou rayé bicolore.
Au bord de l’Aude, les gamins rêvaient du pagne de Tarzan ou de quelque chose d’approchant. Leurs premiers maillots furent des espèces de culottes de laine, tricotées par les grands-mères et serrées à la taille par une ganse de tissu élastique. Tant qu’ils ne surent pas nager, ils s’en contentèrent. Mais au début du mois d’août après leurs premières brasses en apnée, ils en étaient déjà aux plongeons. Ce fut la catastrophe, la Bérézina. A chaque coulée les maillots glissaient jusqu’aux chevilles et une fois rajustés ils s’étiraient tellement que la basse anatomie se mettait à nager à part. Il fallait remettre de l'ordre avant de se relever car dès qu’on s’éloigne un peu des rochers on a pied.
Suite aux doléances, les mémés devinrent plus expertes et tricotèrent plus serré. Pour sa part, Justin eut recours à l'esprit créatif de Jeanne Marre, la culottière de la rue Malcousinat, qui lui confectionna quelque chose de seyant, et il devint modèle de couture sans l'avoir cherché.
C’est vers cette époque qu’il découvre que les filles sont jolies et certaines plus que d’autres, surtout les grandes. Il y a même des fleurs sauvages, inaccessibles edelweiss, comme Sarah, petite fille de monsieur Rey, le roi des gitans. La brune Violette n’est pas mal non plus. Les gamins aiment déjà en secret et fantasment sans espoir car les mariages sont généralement arrangés entre familles. Ils sont tellement timides et maladroits, les Cyranos en culotte courte, que les jolies gamines ne se douteront jamais de leurs adorations secrètes.
Justin se demande comment ça se fait que les jeunes filles soient si belles alors que les femmes mariées sont le plus souvent repoussantes. Sa mère par exemple, a un derrière trop gros à son goût et il se demande ce qu’un beau garçon comme son père peut lui trouver d’intéressant. Parfois il ferme les yeux et s’imagine. C’est proprement répugnant !
Il sait aussi que certains hommes sont tentés d’aller croquer ailleurs le piment qu’ils ne trouvent pas chez eux. Il se rappelle, par exemple, le menu scandale d’un soir d’été, avant la guerre. Ce jour-là, il avait accompagné mémé Camille à la visite quotidienne chez sa sœur, tandis que tante Mathilda était restée à la maison pour corriger les devoirs.
![]() Ils
avaient sorti les chaises et s’étaient assis en rang d’oignons devant
les magasins, depuis le début de la devanture de Moïse le coiffeur
jusqu’à la fin de celle de l’oncle Louis, raides comme des chanoines
dans les stalles du chœur. Il y avait, outre Moïse et sa petite famille,
Madame Moulis sa belle-mère, Madame Raynaud qui tient restaurant
à l’angle de la Goutine, Madame Cassis et sa fille Jeannette qui
chante aux vêpres, l’oncle Louis et aussi l’oncle Hippolyte, le seul
à avoir connu l’Empire, et sa fille tante Brigitte avec sa descendance
et Numa son beau-fils, mémé Camille et sa sœur tante Jeanne,
le cousin Raoul et sa femme et quelques poignées de gosses, enfants,
petits-enfants, petits-neveux ou arrière-petits-neveux des précédents.
Ils
avaient sorti les chaises et s’étaient assis en rang d’oignons devant
les magasins, depuis le début de la devanture de Moïse le coiffeur
jusqu’à la fin de celle de l’oncle Louis, raides comme des chanoines
dans les stalles du chœur. Il y avait, outre Moïse et sa petite famille,
Madame Moulis sa belle-mère, Madame Raynaud qui tient restaurant
à l’angle de la Goutine, Madame Cassis et sa fille Jeannette qui
chante aux vêpres, l’oncle Louis et aussi l’oncle Hippolyte, le seul
à avoir connu l’Empire, et sa fille tante Brigitte avec sa descendance
et Numa son beau-fils, mémé Camille et sa sœur tante Jeanne,
le cousin Raoul et sa femme et quelques poignées de gosses, enfants,
petits-enfants, petits-neveux ou arrière-petits-neveux des précédents.
Au débouché de la rue saint Martin, à l’autre coin de la place, se forme un tohu-bohu. C’est une joyeuse troupe de conscrits et de fêtards parmi lesquels l’œil de faucon de Justin discerne la haute stature de son père.
Ils sont une douzaine, très éméchés, chantant à tue-tête ou simulant une querelle. En s’approchant de la Goutine, ils se mettent à hurler :
Ces soirées de gaudrioles n’existent plus. La pénurie est maintenant partout. Akéla avait bien raison. La "vache sérieuse" a remplacé la "vache qui rit" sur les rares tartines, et encore on n’en obtient que très peu et contre des tickets. L’ersatz de savon ne mousse pas, la saccharine a un goût bizarre, les lames de rasoir se négocient au marché noir, la laine et le tissu sont rares. Les semelles de cuir font partie des vestiges et deux camarades de Justin viennent en classe avec des sortes de sandales faites d’un lambeau de pneu d’automobile et tenues par une ficelle.
Au magasin de monsieur et madame Riu-Sarda, on propose aux élégantes une chaussure à semelle de bois articulée. Chez les pauvres on fait une éternité d’une paire de souliers, de ressemelage en ressemelage, aussi achète-t-on aux enfants des godasses avantageuses qu’ils portent au début avec une première de feutre ou de liège en attendant d’attraper la bonne pointure. C’est la grande époque du "système D" (comme débrouille), des poêles à sciure et des marmites norvégiennes. On recycle tout, on récupère, on ne gaspille rien.
Justin et ses copains, devenus un tantinet brailleurs avec l'âge, se laissent aller à chanter des grivoiseries d'actualité :
 Rue
des remparts, en haut de la Goutine, le bordel a éteint sa loupiote
car l’heure de la vertu a sonné. Rire en public est devenu incongru.
Il est encore permis aux grandes personnes de siffler ou de fredonner en
travaillant au vent, surtout des airs d’espoir comme la Chanson du Maçon
ou le Vieux Chalet, mais chanter au café comme faisait le grand-père
serait maintenant perçu comme un acte d’indignité nationale
et une offense aux soldats prisonniers en Allemagne. Anne-Colette n’est
plus là pour roucouler :
Rue
des remparts, en haut de la Goutine, le bordel a éteint sa loupiote
car l’heure de la vertu a sonné. Rire en public est devenu incongru.
Il est encore permis aux grandes personnes de siffler ou de fredonner en
travaillant au vent, surtout des airs d’espoir comme la Chanson du Maçon
ou le Vieux Chalet, mais chanter au café comme faisait le grand-père
serait maintenant perçu comme un acte d’indignité nationale
et une offense aux soldats prisonniers en Allemagne. Anne-Colette n’est
plus là pour roucouler :
Les bals sont interdits depuis lurette
ainsi que le fameux carnaval. La seule exception concerne les mariages.
Pourtant quelques jeunes gens et jeunes filles se retrouvent parfois dans
une cave dont ils obturent le soupirail et dansent au son d’un phono au
volume réglé bas. Ils risquent gros et pourraient même
être déportés en Allemagne où le travail forcé
dans une usine de guerre leur ferait bien les pieds selon les vieilles
bigotes plus rabat-joie que jamais. Ces sauteries cavernicoles s’appellent
des "bals défendus". Ce sont de petits actes de résistance,
même s’ils sont agréables et poussent au rapprochement. Toute
fantaisie vestimentaire ou capillaire est suspecte d’américanisme
et les miliciens veillent au grain. Ils voient des zazous partout, de futurs
terroristes pour sûr.
Les enfants de la rue restent bons camarades, unis dans leur monde à eux, contemplant le spectacle d’une société saoule qui mélange tout, n'y voit plus clair et ne sait plus à qui se fier.
Ils chantent sur l’air de Lili Marlene :
Encore l’an dernier Justin avait un copain, André, qui avait un an de plus que lui. C’était un garçon réfléchi mais plein d'humour, sans pareil pour faire mousser une histoire drôle. Il ne voulait pas dire où était son père, il disait qu’il ne savait pas. Il portait un nom banal, peut-être un faux à cause des Allemands. Sa famille avait été très riche quand ils habitaient Paris. Sa mère était gentille, discrète et distinguée, et sa grande sœur une très belle fille. Ils étaient venus se réfugier rue de la Mairie et tout le monde les aimait dans le quartier.
André était de la haute et il ne se joignit pas à la bande, mais on le rencontrait aux réunions scoutes où l’abbé Siau l’avait pris en amitié. Justin est très fier d’avoir eu un copain juif pendant la guerre, c’est rare.
Ils étaient restés près
d’un an et un beau jour, tout comme Hibou, ils ne furent plus là,
pfuitt, disparus.
Guy Roves
Justin le marin